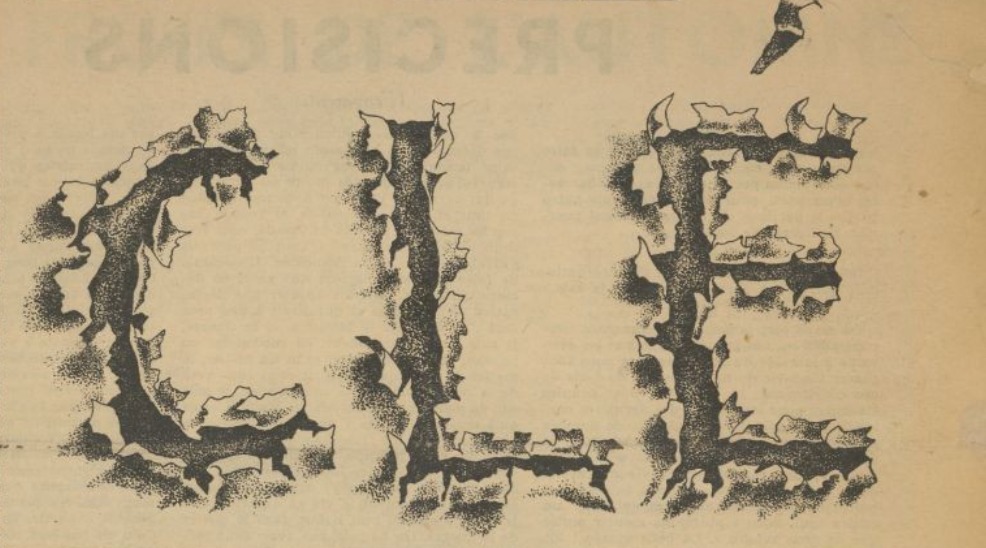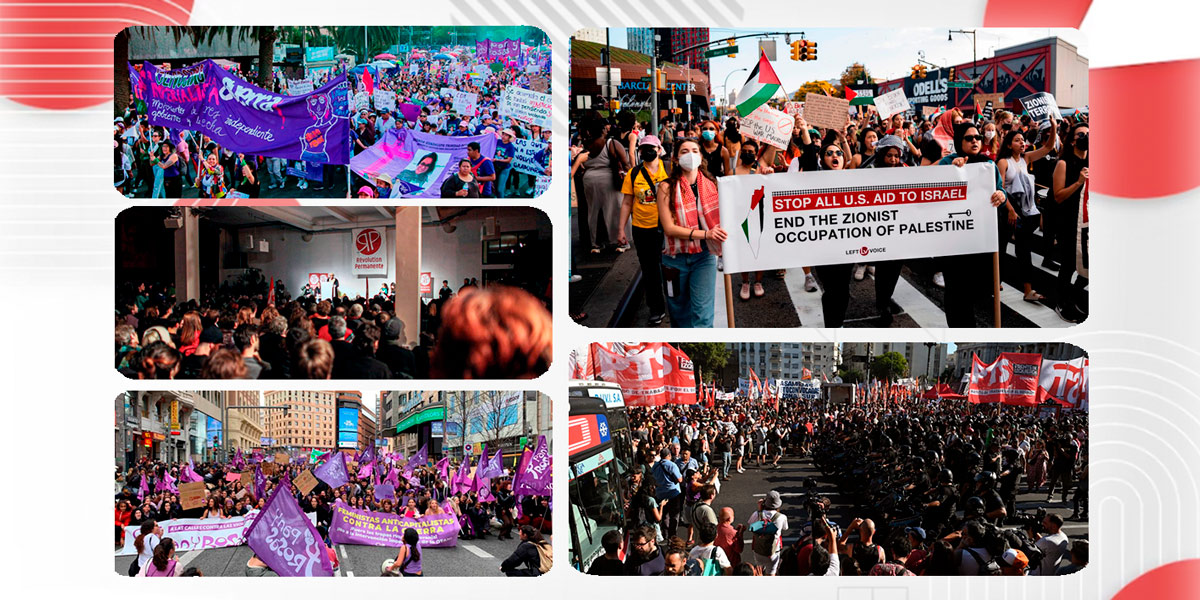Crédit photo : Sauvons l’école
Nous reproduisons ici un extrait du chapitre 2 de l’ouvrage d’Emmanuel Barot "Révolution dans l’Université", qui constitue un bilan critique de la mobilisation contre la LRU de 2009. A l’heure où les débats stratégiques commencent à se faire jour dans la mobilisation de l’ESR contre la LPPR et la réforme des retraites, et tandis que l’enjeu des partiels prend de l’importance dans différentes universités - où certains professeurs mobilisés se refusent à en accepter l’annulation où la transformation la plus favorable aux étudiants - ce livre constitue un témoignage précieux pour penser les modes d’action dans l’ESR et l’alliance professeurs-étudiants que certains appellent de leurs vœux.
Évidemment, le paysage de l’Université n’est pas comparable à celui de 2009, à commencer par celui du mouvement étudiant qui a subi des transformations profondes avec une décomposition des organisations qui le structuraient traditionnellement sans, semble-t-il, recomposition. Aussi, et pour de multiples autres raisons, les étudiants semblent pour le moment encore loin d’être entré massivement dan la bataille aux côtés de leurs professeurs. Tous ceux qui voient dans cette perspective un enjeu central pour la mobilisation contre la LPPR, mais aussi la réforme des retraites, trouveront cependant ici des leçons à méditer sur ce plan.
Les formes de la contestation
Ce qui s’est produit pour la première fois dans l’histoire de l’université française avec cette grève, c’est qu’elle fut initiée par les enseignants-chercheurs eux-mêmes – dont certains présidents d’université – et non par les étudiants. Si ces derniers avaient été à la pointe de la contestation de l’automne 2007, le mot d’ordre de la grève – « L’Université s’arrête » – entré en vigueur au 2 février 2009, fut lancé par la toute nouvelle Coordination nationale des universités (CNU), constituée à l’image des Coordinations nationales étudiantes traditionnellement à la pointe des mouvements étudiants.
Les mois précédents avaient vu se multiplier les déclarations en tout genre, de départements disciplinaires à des sociétés savantes, en passant par des motions dans les conseils centraux des universités, exprimant une irritation croissante directement suscitée par l’injonction, dès la rentrée de septembre 2008, de simultanément mettre en place le plan « Réussite en Licence », la « Mastérisation » de la formation des enseignants, et dans certaines universités les nouvelles maquettes-cadres (les « quadriennaux ») des structures des formations disciplinaires, mais aussi et déjà en raison des dangers associés aux contenus de ces réformes. Mais ce sont clairement la mastérisation et le projet de décret modifiant le statut de l’enseignant-chercheur qui ont fait sauter le couvercle de la cocotte.
Les six semaines qui ont suivi ce mot d’ordre ont été celles d’une grève du zèle, grève dite « active » dans des universités « critiques mais ouvertes ». Lors de cette période un nombre certain d’EC – jusqu’à 100 000 en manifestation – ont arrêté de dispenser leurs cours habituels au profit de dialogues à caractère d’abord informatifs au sujet des dangers des réformes à l’oeuvre, puis de rencontres menées sous le sceau d’expérimentations pédagogiques variées, « alternatives ». Cette période a été notamment marquée par l’existence d’assemblées générales inédites, lieux de rédaction de motions ou de déclarations et de votes effectués en commun par les enseignants, les personnels administratifs et les étudiants présents.
Née à la base, c’est-à-dire dans les composantes locales (départements mono-disciplinaires ou Unités de formations et de recherches, regroupant plusieurs départements), cette protestation a salutairement désatomisé les relations habituelles de simple coexistence en suscitant une première habitude de s’unir, pour protester, avec son Autre – étudiant ou BIATOS. Et cela s’est produit avec une effervescence, une certaine bonne humeur, et très certainement une spontanéité un peu désordonnée liée au fait majeur que la plupart des EC impliqués n’étaient pas habituellement engagés, notamment dans le cadre syndical. Première mémoire d’une lutte dont la forme revendicative a été essentiellement éthique et culturelle, « alternative », et par rapport à laquelle les organisations syndicales et militantes, avec leurs modes d’intervention traditionnels ont très clairement été en retrait.
Ces différentes approches et formes de la protestation ont mis longtemps à converger – et encore n’y sont-elles jamais pleinement arrivées. En témoigne, en plus des AG étudiantes autonomes, la coexistence plus ou moins tendue des habituelles assemblées générales (AG) des personnels du site, dominées par les militants syndicaux, et ces nouvelles AG locales dans lesquelles les EC, sans tradition militante pour la plupart, ont été assez souvent indifférents – voire franchement méfiants – à l’égard des représentants syndicaux, alors minoritaires.
Une première raison objective de cette méfiance est que l’institution universitaire est gérée en temps de crise par ceux qui la cogèrent en temps normal (jusqu’ici du moins, les directions des universités étaient encore composées d’élu-e-s EC puisés dans les appareils syndicaux dominants). Il était donc à leurs yeux peu imaginable que les appareils syndicaux ne mènent la grève à l’encontre de ce cadre cogestionnaire, ou ne la mènent sur des lignes suffisamment renouvelées. Ce qui ne signifie pas que ces EC, à distance des habitudes et traditions syndicales, n’aient pas exprimé des contradictions de même nature, on va le voir, au travers de leurs engagements « alternatifs ».
Un large spectre de pratiques alternatives
D’ores et déjà il est important de noter combien ce qualificatif d’« alternatif » – à l’usage surabondant pendant toute la grève – a recouvert un spectre extrêmement large de pratiques, tendu entre deux extrêmes, avec toutes les gradations intermédiaires.
D’un côté les « programmes alternatifs » ont eu tendance à mimer de facto les calendriers normaux, avec leurs rythmes, leurs horaires, leurs chevauchements, parfois leur division du travail (l’enseignant spécialiste fait sa « conférence alternative » dans un amphithéâtre sur le mode classique de la séparation enseignant- enseigné), et même jusqu’au contenu : beaucoup de cours « alternatifs » ont ressemblé comme deux gouttes d’eau aux cours normaux !
Mais se sont aussi faites jour des expériences en rupture réelle en matière d’intelligence collective, anti-individualistes, égalitaires, où les connaissances et expériences de chacun ne se sont pas seulement mises en scène sous la forme d’échanges un peu plus à double sens qu’à l’habitude, mais de la contribution à un objectif commun de plaisir, d’instruction et de découverte partagés déliés des injonctions du système. L’« alternatif » fut donc le fourre-tout par excellence – un peu à l’image de la constellation « altermondialiste » – dont les contradictions de fond ressortiront un peu plus loin.
Se souvenir de cette période comme d’une expérience collective riche et productrice de solidarité est pleinement justifié. Pourtant, il n’y a qu’un pas, vite franchi, vers l’autocongratulation. On omet souvent de rappeler que cette grève du zèle est restée très symbolique : tous les enseignants qui n’ont pas souhaité se joindre à cette protestation ont pu assurer leurs cours – tout comme les personnels administratifs et techniques ont pu effectuer leurs services – comme si de rien n’était. Les universités ont tranquillement continué de tourner dans leurs structures centrales. Bref, contrairement au mot d’ordre et à la contestation qui l’a portée, l’université ne s’est en rien « arrêtée » pendant ces premières semaines.
Raison pour laquelle il n’y eut à peu près aucune réaction de la part du pouvoir sur cette période. C’est au contraire le passage aux piquets de grève et à l’occupation des locaux – aux « blocages » –, par les étudiants, qui a été le moment où le gouvernement, du premier ministre Fillon à Darcos pour l’Éducation nationale et Pécresse pour le Supérieur et la Recherche ont été obligés de reconnaître l’existence de ce « mouvement ».
Les « blocages » ou la politisation étudiante de la culture
« Contrairement à ce qu’on veut faire croire, les étudiants ne refusent pas qu’on leur enseigne quelque chose ; ils demandent simplement le droit de discuter ce qu’on leur enseigne, de vérifier que cela tient debout, de s’assurer qu’on ne leur fait pas perdre leur temps. Vous n’imaginez pas le nombre de bêtises qu’on m’a enseignées quand j’étais étudiant… » (J.-P. Sartre, « L’idée neuve de mai 68 »)
Criminalisations de la grève
Le « blocage » – piquets de grève, occupation d’une partie des locaux, et impossibilité d’accéder à tout ou partie des autres – fait traditionnellement l’objet d’attaques variées, très exactement comme les grèves et les occupations d’usine de longue date. Certains pensent « sincèrement » que cette modalité d’action est contre-productive, implique une désaffection et une perte d’effectifs, vide les campus d’une façon inacceptable pour l’opinion publique. On affirme aussi qu’il est contradictoire : il empêche les enseignants de dispenser leurs savoirs, alors que dans le principe, au contraire, ceci constitue l’une des armes de la résistance aux attaques contre les missions de l’université, ce qui justifierait la formule de « l’université critique mais ouverte », c’est-à-dire « en grève mais pas bloquée » (sic).
Pour autant cette formule, sous couvert de la défense de la démocratie contre les atteintes à la liberté de travailler (pour les personnels) et d’étudier (pour les étudiants), fut bien souvent ni plus ni moins que celle-là même de l’acceptation des réformes. Entre les deux, dans toutes les catégories de personnels comme chez les étudiants, toute une série de positions intermédiaires expressives de tiraillements dont je parlerai plus loin.
Les blocages sont évidemment porteurs de division : les actions minoritaires, même votées largement en AG, violentes ou non, ne valent pas les actions collectives d’ampleur par lesquelles la lutte démocratique s’accomplit avec le plus de sens et d’efficace. Mais on n’oubliera pas que les actions collectives sont un processus dynamique, jamais quelque chose que l’on décrète. Elles sont construction de convergences tactiques et stratégiques : jamais les luttes sociales ne commencent par elles.
La nature minoritaire d’une contestation n’est pas comme telle ce qui fait qu’elle a tort : mais c’est bien ce qui fait qu’elle doit parfois passer par des biais non consensuels porteurs de tensions, pour lesquels elle est toujours, à des degrés divers, du plus modéré au plus réactionnaire, stigmatisée (« corporatiste », « vouée à l’échec », etc.), criminalisée (« irresponsable », « violente » et « anti-démocratique ») et culpabilisée (« usagers pris en otage », etc.).
L’une des traductions du révisionnisme de la démocratie réduite à sa forme parlementariste et représentative, dominée par la figure du « dialogue social négocié », c’est la sentence selon laquelle le gréviste est un proto-terroriste, khmer rouge ou apprenti-dictateur – et qu’il faudrait nettoyer à coups d’antiterrorisme local. Marx avait formulé de façon limpide la situation dans La guerre civile en France (1871).
« Le bourgeois de nos jours se considère comme le successeur légitime du baron de jadis, pour lequel toute arme dans sa propre main était juste contre le plébéien, alors qu’aux mains du plébéien la moindre arme constituait par elle-même un crime. » (Karl Marx, La Guerre civile en France, 1871).
Une grève est là pour perturber en profondeur un ordre établi : condamner une grève pour cette « violence », c’est la condamner par essence. Certes, ceux qui n’ont rien demandé subissent : mais il serait bien qu’ils ne se trompent pas de cible, et ne confondent pas l’agresseur et l’agressé.
La protestation « alternative » s’est en tout cas d’abord présentée et représentée comme une université non bloquée et en grève, protestation au nom de et rendant possible une réappropriation libre et sans contrainte du rapport au savoir. Pourtant ce sont clairement ces blocages et ces occupations qui ont permis que l’alternatif dure et prenne en épaisseur, en dégageant du temps et de l’espace pour toutes ces pratiques qu’ils recouvrent. Nombre de manifestations « hors les murs », de cours sur des places publiques, dans les métros, etc. se sont produites au cours de cette période, mais il ne faut pas oublier que les pratiques alternatives ont trouvé quotidiennement, grâce aux occupations, les moyens de se pérenniser sur les campus.
C’est en cela que les « blocages » et les occupations ont été le moment majeur de politisation de la grève : celui lors duquel les espaces et les temps de l’institution ont été détournés de leurs fonctions et objectifs de production et de reproduction de la force de travail.
Les pratiques alternatives ont bien également détourné et publicisé, sur un même plan, les pratiques d’enseignement (et de recherche). Mais il y a une différence de nature entre les deux : ce détournement, dans le premier cas, fut pensé et pratiqué comme moyen de l’instauration d’un rapport de forces imposant la cessation du fonctionnement normal de l’appareil universitaire, pratique de sabotage politique donc, alors que les secondes, comme telles, pouvaient, peuvent, et ont pu avant les blocages parfaitement coexister avec ce fonctionnement normal (des cours, des services administratifs, etc.). De la radicalisation de la grève aux CRS dans les campus Au moment où les étudiants sont entrés dans la danse, durant la première quinzaine du mois de mars, cette grève culturelle s’est donc progressivement socialisée-politisée et radicalisée à la mesure.
Les personnels BIATOS n’ont pu pour des raisons objectives (risque de pertes de salaires corrélatives du sentiment diffus de l’ambiguïté politique des EC, dispositifs efficaces de surveillance et de contrôle par leurs hiérarchies, fragilité générale issue de la multiplication des contrats précaires et peur justifiée de leur non-renouvellement, etc.) s’engager comme ils le souhaitaient, bien que leurs organisations syndicales locales soient le plus souvent restées sur des lignes dures. Et même si ces blocages ont permis de faire durer l’alternatif, très clairement les EC ont majoritairement commencé à prendre de facto leurs distances tout en exprimant leur soutien officieux aux étudiants, parfois à reculer, et le plus souvent se sont rapprochés des habitués de ce genre de situation : les organisations syndicales (chez les EC, SNESUP, majoritaire, SUD-Éducation2, la fraction non collaborationniste du SGEN-CFDT, CGT, et chez les BIATOS, CGT, FO et UNSA grosso modo). C’est à ce moment-là que celles-ci sont revenues en première ligne, sur leurs mots d’ordre socio-économiques (et non « culturels ») traditionnels, et cela selon une proportion croissante au bénéfice des AG générales de site et au détriment des autres.
Parler des blocages étudiants comme d’un moment clé dans la périodisation de la grève ne signifie pas que les universités qui n’ont pas connu de blocage – il n’y a pas besoin d’enquêtes statistiques extrêmement développées pour savoir que ces dernières ont été de loin les plus nombreuses – n’ont pas connu cette politisation : la différence présumable, c’est l’ampleur et l’intensité de cette politisation et le degré de radicalisation des positions antagonistes sur la grève, logiquement favorisés par les piquets et les occupations qui empêchent l’université de fonctionner. Néanmoins l’entrée au plan national dans la période des blocages a pu avoir de l’incidence sur les universités qui n’en ont pas connu, ne serait-ce que par leur médiatisation, par les débats que le procédé suscite toujours, et par le niveau de conflictualité auquel il a vocation à élever une protestation. À partir de la mi-mars, et selon les universités au plan national, c’est néanmoins une période de blocage de plusieurs semaines à plusieurs mois qui a eu lieu, dont le tournant, globalement à partir de la fin avril, fut la question des examens – c’était prévisible. Le travail de sape, les pressions sur les étudiants et les personnels, l’isolement de cette grève par rapport aux conflits sociaux dans leur ensemble, l’épuisement, l’inflexibilité du pouvoir, et finalement, les interventions policières, la destruction des piquets, et les quadrillages des campus, ont finalement eu « objectivement » raison de la contestation dans son ensemble, approximativement la première semaine de juin pour les dernières universités.
Mais cette « objectivité » ne doit pas voiler les différentes contradictions qui ont affecté toute cette grève, et surtout le fait que sa victoire aurait été contradictoire par rapport à la structure de classes de l’université et aux positions de classe différenciées de ses agents. Il faut le dire clairement : sans les étudiants, c’est-à-dire sans les piquets et les occupations à la mi-mars, tous les EC, syndicalistes inclus, auraient été partout de retour au travail à la mi-avril, sans même que le pouvoir d’État n’ait à bouger plus d’un orteil.
On notera donc ici une double défiance d’ensemble à l’égard des appareils syndicaux : d’une part celle des EC eux-mêmes, déjà évoquée, d’autre part celles des étudiants nourrissant et défendant piquets de grève et occupation, également caractérisés par une profusion de pratiques aux tonalités libertaires et auto-organisationnelles. Cet antagonisme proprement politique exprime un rapport qualitativement différent à la logique cogestionnaire, et ne se réduit pas à un simple déphasage entre des jeunes (plus ou moins excités) et des moins jeunes (plus ou moins installés et assagis). Cet antagonisme contre le double appareil universitaire et syndical ne s’est certes pas manifesté dans tous les lieux de la mobilisation et lorsque ce fut le cas, ce fut toujours dans des formes singulières. Mais l’on peut noter au moins que cette contestation l’a réactivé. Cet antagonisme entre « le moment unitaire, qui échoit à l’organisation politique de la classe, et les moments d’autogouvernement, les conseils, les groupes en fusion », est « irréductible » selon Sartre.
« Entre les deux moments il ne peut y avoir qu’une tension permanente. Le Parti [ici le syndicat] tentera toujours, dans la mesure où il veut se considérer « au service » du mouvement, de le réduire à son propre schéma d’interprétation et de développement ; les moments d’autogouvernement tenteront toujours de projeter leur vivante partialité sur le complexe contradictoire du tissu social. » (J.-P. Sartre, « Masses, spontanéité, parti »2)
Cette tension est-elle irréductible ? Si c’est le cas, rien n’empêche, pourtant, de travailler à sa résorption la plus grande possible, nous y reviendrons dans le dernier chapitre.
En tout cas, cette tension épouse pleinement les différences de générations ou de statut. Lors du printemps 2009, si les EC ont pu jusqu’à un certain point, dans la première partie de la grève, incarner cette expérience de la diversité agissante, les syndicats étudiants (UNEF, AGET-FSE, SUD, parfois CNT) ou partis (UEC, NPA, quelques organisations anarchistes ou libertaires) aux taux d’implantation variables2, ont parfois témoigné, pour les plus affiliés aux grands partis réformistes, de ce qu’ils sont plus syndicats qu’étudiants, c’est-à-dire déjà substantiellement intégrés à des logiques d’appareil, et cela même si l’appartenance de classe d’un étudiant quel qu’il soit est virtualisée en raison de sa position sociale par définition transitoire.
Je ne parlerai pas ici de l’opposition étudiante, cela exigerait un temps et un espace dont je ne dispose pas – j’y viendrai en d’autres lieux. Mais il convient du moins de dire que ses formes, plus radicales et plus impressionnantes que l’opposition des personnels dans ses actions les plus manifestes, ses prises de liberté, ses innovations, et évidemment sa reconnaissance assumée de la violence du système pour ses franges les plus engagées, ne doivent néanmoins pas être prises pour le tout du mouvement étudiant. Derrière les groupes les plus impliqués, ce mouvement reste structuré à proportion de celui des personnels par des contradictions, des ambiguïtés et des inerties d’autant plus contrastées que les populations étudiantes, à l’université, sont très hétérogènes – jusque dans leurs franges les plus radicales.
Mauvaise foi
L’inconséquence « stratégique » continuée et majeure de cette grève s’exprime d’abord par le fait que la grève du zèle n’a pas empêché les cours de se tenir ni les universités de fonctionner : une grève, donc, qui n’en fut pas une. Le passage à la grève proprement dite n’a été rendu possible que par les piquets et les occupations.
Or, et cela n’a rien de nouveau, l’immense majorité des EC et de leurs organisations syndicales (à la différence de certains représentants syndicats BIATOS, parfois dans la même fédération) ont laissé les étudiants assumer seuls cette opération de « sabotage ». Refus de prendre ses responsabilités exprimant une mauvaise foi dont la formule emblématique se résume dans la réponse standard donnée par un EC à la question standard « Êtes-vous pour ou contre le blocage ? » : « C’est l’AG étudiante souveraine qui vote le blocage, nous ne sommes pas responsables ! » Seule une minorité des personnels a exprimé son soutien et participé publiquement à l’opération, comme seule une minorité a choisi de démissionner de certaines fonctions de direction de façon non symbolique pour bloquer l’institution. Les étudiants et les personnels BIATOS sont depuis plusieurs années la cible avancée, la plus fragile évidemment, du processus de précarisation qui affecte dorénavant le corps enseignant. Une suspicion manifeste s’était manifestée chez eux au début de la grève à l’égard des EC : où étaient les enseignants avant ce printemps 2009 ? Nulle part. Se seraient-ils mis en grève si leur statut n’avait pas été frontalement attaqué ? Peu probable. Bien minoritaires étaient ceux en lutte dès l’automne 2007 contre la LRU...
Pourquoi cette absence ? Est-ce à cause de cette « courte vue », de cet « aveuglement », cette « non-conscience » comme on le dit souvent ? En première approximation, et de façon volontairement polémique, l’on dira oui, mais dans la mesure où cet aveuglement était très clairement aussi complice que naïf, le fond en étant que les intérêts de classe des EC allaient à l’encontre de cette première résistance. Cette suspicion, progressivement passée au second plan au cours de la grève, en est sortie partiellement renforcée, puisque derrière la profession de foi unitaire, ce sont bien de telles divergences d’intérêts qui rendent raison de ce reflux des cadres (enseignants et administratifs), suspicion que les logiques importantes et à la fois contrastées de renoncement, visibles depuis la rentrée de l’automne 2009, ne manquent pas de nourrir.
L’enjeu des examens : la reproduction de la force de travail
La reproduction de la force de travail, à côté de ses conditions matérielles (bourses, futurs – et hypothétiques – salaires), doit toujours satisfaire à des conditions légitimantes, celles qui expriment l’attente sociale et culturelle des futures forces de travail, et en particulier celle du diplôme, donc des examens qui en légitiment l’attribution. L’institution trouve en eux sa justification, les étudiants leur objectif, et c’est par là que la jeunesse est, selon le mot de Sartre, « piégée ».
Cette question des examens est assez éclairante sur la période de transition actuelle. Lors de la grève universitaire de 1976, la sanction finale fut : pas d’examens sans cours. Les contenus des cours réellement assurés furent contrôlés de façon quasi policière, et cela après six mois de grève. Si en 2009 le même discours a été tenu, la tendance réelle fut de considérer que des examens allégés feraient l’affaire pour autoriser une délivrance des diplômes digne de ce nom, même si la focalisation officielle, surmédiatisée, autour des examens, s’est faite au nom de la défense de leur « valeur » – l’alibi est bien connu. [1]
Nombre d’EC et d’étudiants semblent s’être partiellement distanciés à l’égard des examens, ce qui indique un changement de leur rapport à leur fonction et leurs effets : le taux de chômage et la dévalorisation de la culture ont très clairement amoindri leur impact et leur signification antérieurs. Voilà pourquoi, par exemple, un nombre croissant d’étudiants furent prêts à s’engager au point de perdre leurs diplômes, quitte, pour donner le change, puisque la situation sociale est transitoire et le besoin du ticket d’entrée sur le marché du travail encore présent, à demander la « validation automatique » des examens. Ceci à la fois a continué de faire des examens un élément central des revendications, tout en les vidant politiquement de leur fonction de sélection, c’est-à-dire de leur contribution à la reproduction de la division hiérarchisée du travail. La conscience de cette implication est restée très partielle, ce mot d’ordre signifiant avant tout deux choses pour ses porteurs. D’une part, conséquences des réformes, les contenus pédagogiques s’annoncent d’un niveau, qualitatif et quantitatif, considérablement amoindri ; d’autre part et corrélativement, la lucidité va croissante sur la déconnexion structurelle entre la « vertu » du diplôme dans le « monde du travail » d’aujourd’hui, et la socialisation des savoirs comme telle.
Les examens et les concours, qui concentrent l’ensemble des enjeux, ont été un principe de division majeur (comme ce fut systématiquement le cas pour le baccalauréat depuis 1968). Tout est focalisé sur eux, parce que l’université est structurée autant par la sanction sociale que par la reconnaissance d’une maîtrise des savoirs. En ce sens, sacrifier une grève à la tenue des examens c’est la sacrifier à la fonction réelle de l’institution, qui n’est pas la diffusion libre et égalitaire, émancipatrice, de savoirs indépendants du marché, mais la reproduction d’une force de travail hiérarchiquement qualifiée, avec le diplôme comme proto-salaire.
[1] Des composantes ou des départements ont imposé un rythme intense de rattrapage par les enseignants eux-mêmes (et non par les instances gouvernementales ou rectorales). Mais ce ne fut pas nécessairement, voire pas principalement, l’indice d’un souci de donner un contenu réel aux diplômes. C’est plutôt la volonté caporalisée, dans un contexte de concurrence accrue des universités, de redorer publiquement l’image « fumiste » des universités très mobilisées et de faire payer aux étudiants leur engagement qui s’est exprimée là.