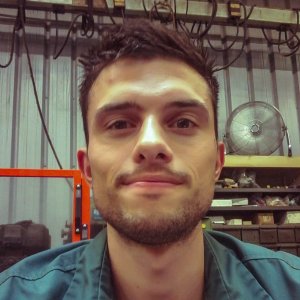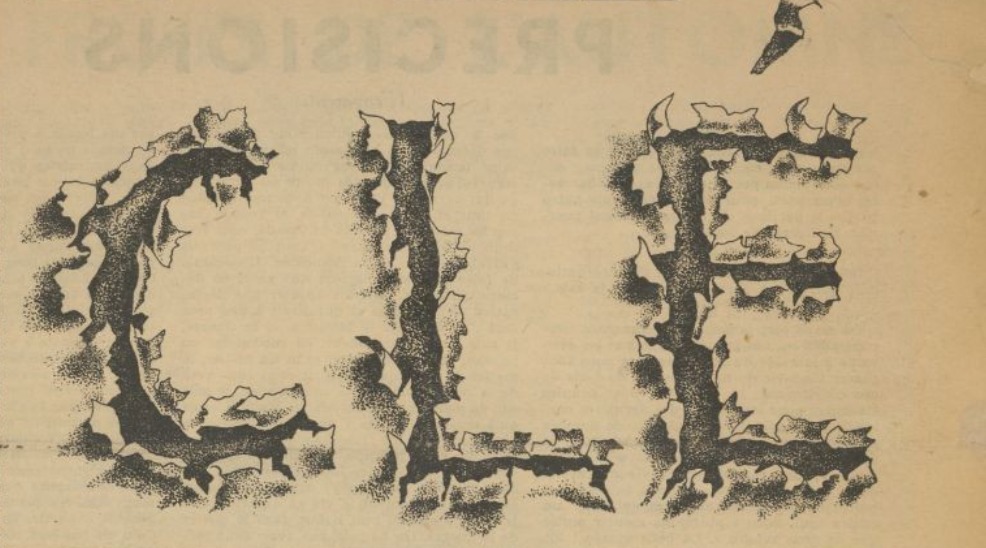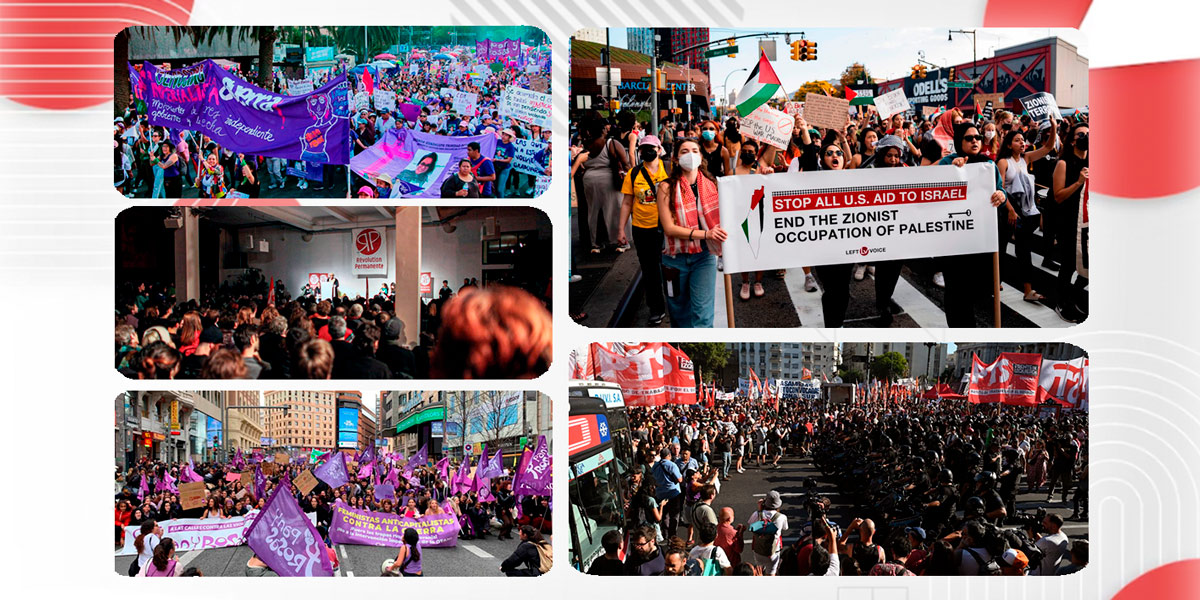« La fermeture de notre usine, c’est acté, on peut pas l’empêcher ». C’est ce que m’explique un salarié d’un sous-traitant aéronautique, dont l’usine a annoncé sa fermeture et le licenciement de la cinquantaine de salariés du site.
« C’est vraiment chaud de faire plier le patron sur le PSE », m’explique un autre syndicaliste d’une usine du secteur.
Souvent c’est le même constat. Il est difficile de construire un rapport de force à la hauteur des attaques qu’on reçoit. En observant ce phénomène à la surface seulement, on serait tenté de conclure par ce préjugé qu’on entend parfois : « les gens ne veulent plus se mobiliser ».
La passivité, la démoralisation, serait générale. Et pourtant, pour peu qu’on plonge notre analyse sous la surface, et suffisamment profondément, on observe que cette passivité est relative, qu’elle ne traduit pas une acceptation de la politique du gouvernement, mais surtout que les directions des syndicats en ont la principale responsabilité. Explications.
Des difficultés objectives bien réelles : exemple dans l’industrie
Premièrement, il est évidemment vrai que face à la crise économique, à la possibilité de perdre son emploi, la peur existe dans notre classe sociale. Mais au-delà de cette peur plus ou moins forte, la situation très particulière que nous vivons ajoute des difficultés objectives à la construction d’un rapport de forces.
Dans de nombreuses usines, une grande partie des salariés se trouve en chômage partiel, loin du cadre collectif et des collègues. Parfois la division est encore plus forte, avec l’utilisation du chômage partiel individualisé (qui permet au patron de choisir qui reste chez lui et qui travaille), la mise en place d’équipes en horaires décalées, la fermeture souvent des lieux de restauration collective, et autres mesures qui, bien qu’ayant une justification sanitaire - plus ou moins réelle selon les situations -, brisent en même temps les collectifs de travail et les liens entre collègues, approfondissant la logique profonde qui est celle du néo-libéralisme depuis les années 80.
Combiné à la baisse de la demande, dans des secteurs comme l’aéronautique par exemple, les salariés sentent bien que s’il doit y avoir une lutte, ce n’est pas une grève de deux jours qui impactera le patron. Parfois, les directions ont même prévu le coup pendant l’été, en faisant faire des heures supplémentaires aux salariés pour remplir les stocks, et ainsi se préparer à tenir plus longtemps en cas de grève dure. C’est l’attitude du patron de Toray, usine de composite dans le 64, qui a annoncé un PSE ce mois-ci.
Si on ajoute à cela la situation sanitaire, les différentes mesures restrictives et le re-confinement, c’est une barrière supplémentaire à la mobilisation, aux assemblées, aux appels à soutenir physiquement sur les piquets de grève ou les rassemblements.
De plus, pour poursuivre l’exemple de la filière aéronautique, les donneurs d’ordre comme Airbus visent à la « consolidation de la sous-traitance », comprenez réduire le nombre de sous-traitants via des fusions et la fermeture des « moins solides ». C’est l’objectif principal du fonds d’investissement lancé dans l’aéronautique dans le cadre du "plan aéronautique de 15 milliards" annoncé par le gouvernement. Autrement dit, si le patronat de la filière cherche à fermer lui-même certaines usines, une grève restant isolée, chez un de ces sous-traitants, aura un rapport de force limité.
Pourtant, la situation n’est pas la même si l’on prend en compte l’ensemble de la filière (et encore plus l’ensemble du patronat français). Si étant donné toutes ces conditions objectives, le patronat peut se permettre quelques grèves isolées ici ou là, si Airbus a effectivement diminué sa production, il n’empêche qu’ils doivent produire quand même ! Airbus a d’ailleurs annoncé qu’il voulait maintenir une cadence de 40 A320 par mois jusqu’à l’été 2021, voire de remonter à 47 par mois possiblement ensuite.
Une grève générale dans le pays, et même seulement dans la filière, serait un sérieux problème pour le patronat, dont la concurrence capitaliste n’a pas disparu, mais au contraire s’accentue en temps de crise. Airbus cherche par exemple à profiter au maximum de la crise de Boeing pour gagner des parts de marché. On est loin d’un patronat qui n’aurait « plus peur de la grève ».
Enfin, étant donné la profondeur de la crise, la situation se prête encore moins qu’avant à négocier son départ, à chercher à partir avec un « chèque le plus gros possible ». Car aussi gros soit-il, il sera extrêmement difficile de retrouver un emploi ensuite. Encore plus qu’après la crise de 2008, qui a pourtant déjà eu son lot de drames sociaux, et de salariés partis avec des indemnités puis brisés, voire suicidés quelques années plus tard.
Mais une situation qui n’est pas unilatérale
Autrement dit, ces coordonnées particulières interdisent, plus encore que par le passé, des luttes isolées, boite par boite, des luttes timorées dans la forme et timides dans les revendications. Dans une situation où, plus que jamais, seule une lutte générale et dure pourrait briser la volonté du Medef et du gouvernement, l’absence d’un plan de bataille pèse lourdement sur l’état d’esprit à la base. Toutes ces difficultés objectives, les salariés les perçoivent, les sentent instinctivement. Les syndicalistes y compris. C’est cette absence de plan de bataille, ce silence généralisé des directions syndicales, qui entraîne ensuite cette situation particulière dans chaque usine. C’est un facteur prépondérant, qui "pousse" en quelque sorte ensuite les syndicats de base à davantage négocier le moindre mal, étant leur isolement et les difficultés décrites plus haut.
On est loin du concept d’une « bureaucratisation à tous les niveaux des syndicats », que défendent la plupart des sociologues travaillant sur cette question, et qui empêche de hiérarchiser les responsabilités. Car notre classe sociale n’est forte que quand elle est unie dans la lutte, face aux capitalistes et leur Etat, pas quand elle est divisée en une myriade d’entreprises. En ce sens, mettre un signe égal entre l’aspiration des élus CSE dans les IRP (Institutions Représentatives du Personnel) et l’intégration des bureaucraties syndicales à l’Etat capitaliste, c’est raisonner à partir d’outils sociologiques purement « techniques », mais hors de toute perspective politique qui pense le renversement du capitalisme par notre classe sociale (et donc le rapport à l’Etat que cela comprend).
Quand les dirigeants des principaux syndicats sont aux abonnés absents, quand face à la guerre sociale qui nous est déclaré ceux-ci continuent de supplier d’être reçus à Matignon pour « dialoguer » (comme ce mardi encore), et surtout quand aucun plan de bataille ne se dessine à l’horizon, c’est clairement leur responsabilité première qui entraîne la passivité des masses. Il ne faut pas inverser les rôles !
Si l’on ajoute à cela les stratégies de la défaite de ces dernières années, des journées d’action isolées aux trèves de noël en passant par l’évitement des Gilets Jaunes au lieu de la convergence, il est clair que tout cela pèse sur l’état d’esprit des travailleurs aujourd’hui.
Si cela ne suffisait pas pour démobiliser les collègues, les dirigeants des principaux syndicats justifient leur inaction et leur « dialogue social » par une posture qu’on pourrait qualifier de « rassuristes économiques ». Sur l’aéronautique par exemple, on a pu entendre Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, expliquer en septembre 2020 qu’il n’y avait pas de crise réelle du secteur étant donné qu’Airbus avait même « davantage de commandes qu’en septembre 2019 ». Ce chiffre pris isolément traduit mal la dynamique du secteur, qui connaît une crise réelle et profonde, dont nous avons discuté quelques éléments ici, ou que j’ai débattu contre la vision de plusieurs syndicats de l’aéronautique à Toulouse.
Ces discours rassurants, qui ne correspondent pas à la réalité économique, encouragent eux-aussi à ne pas lutter durement, à négocier le moindre mal, à confondre attaques patronales et fatalité économique et à faire le dos rond. « Si on s’attend à une reprise économique dans 2 ou 3 ans, on peut bien faire quelques sacrifices pour tenir », est une phrase que j’ai déjà entendue.
2ème partie :
On ne ne peut pas discuter les perspectives dans l'aéro sans parler de la lutte de classe, sinon toutes nos réflexions seront impuissantes, car les capitalistes n'ont rien à foutre de la question sociale ou écolo pic.twitter.com/rMsyOeQ0kk— Gaëtan Gracia (@GaetanGracia) October 10, 2020
Enfin, l’offensive autoritaire et islamophobe du gouvernement a aussi à voir avec la situation sociale. Par ces attaques qui visent un secteur opprimé de la population, le gouvernement envoie plusieurs messages. Il montre qu’il peut attaquer, stigmatiser, humilier une partie de la population. Tout en poussant à « l’unité nationale », entre une partie des travailleurs et le gouvernement, il divise notre classe entre les musulmans ou assimilés, suspects de près ou de loin de complicité avec le terrorisme, et les autres, forcés de se ranger derrière l’unité nationale et de se rassembler avec les ministres de Macron, sous peine d’être catalogués comme « islamo-gauchistes ». D’ailleurs, cette division et cette atmosphère pesante se ressent sur nos lieux de travail. Un jour, un collègue musulman m’a résumé la situation en une phrase : « avant, on parlait entre nous, de tout, de religion et d’autres choses, que tu sois athée ou croyant. Maintenant, les gens se méfient, et je suis fatigué d’expliquer et de me justifier face à tous ces préjugés ».
Mais surtout, le gouvernement envoie le message suivant : « je peux instrumentaliser un drame, attaquer un secteur de la population, et vos dirigeants syndicaux se rangeront derrière moi ».
Catastrophe sociale, disparition des directions syndicales : nos responsabilités !
Arrivé à cette étape, on pourrait nous répondre : « Mais alors, tant que les directions syndicales n’appellent pas à la grève générale, on ne fait rien ? ». C’est souvent l’argument qui sert à esquiver toute critique des bureaucrates : C’est « à nous militants » et « aux travailleurs » de se mobiliser. Après tout, comme le dit Philippe Martinez lui-même, « il n’y a pas de bouton pour la grève générale ».
Trotsky avait critiqué cette même position à propos du Parti Communiste Français en 1935 dans un texte intitulé « Encore une fois : où va la France » : « Le PC rejette sur les masses ses propres tâches et ses propres responsabilités. Il exige de millions d’hommes, qu’il laisse sans direction révolutionnaire, qu’ils entreprennent des combats dispersés pour des revendications partielles et démontrent ainsi aux bureaucrates sceptiques qu’ils sont disposés à combattre. Peut-être les grands chefs consentiront-ils alors de mener la lutte ? Au lieu de mobiliser les masses, le comité central leur fait passer un examen, leur donne une mauvaise note et justifie ainsi son opportunisme et sa propre lâcheté »
C’est vrai, il n’y a pas à attendre les ordres d’en haut, d’un quelconque chef, pour commencer à construire la riposte. Les révolutionnaires se doivent d’ailleurs, comme l’écrivait Trotsky, d’être les « meilleurs syndicalistes », et donc de prendre toutes les initiatives possibles, que ce soit dans les boîtes où ils sont présents, mais y compris pour chercher à coordonner au maximum les entreprises, pour briser l’isolement. C’est en ce sens que nous construisons le « Collectif des salariés de l’aéronautique » à Toulouse, qui tente de lier entre elles les différentes entreprises du secteur, en réunissant syndiqués de tout syndicat et non-syndiqués, sur la base d’un programme défensif mais d’indépendance de classe (0 suppressions d’emplois, 0 baisse de salaire) et de coordination des luttes (traduit dans le slogan "si on touche à l’un, on touche à tous !"). C’est la même stratégie, d’auto-organisation des travailleurs, qui nous a guidé dans la construction de la Coordination RATP/SNCF à Paris pendant la grève des retraites fin 2019, qui a permis à la lutte de tenir alors que les directions syndicales avaient appelé à la trêve de Noël.
D’autres initiatives locales ou partielles existent. Une partie de la CGT, plutôt « oppositionnelle à la Confédération » disons, (FNIC, UD13, UD94, Fédé Commerce, etc.) a appelé à une manifestation pour l’emploi à Paris le 17 octobre dernier. Les CGT TUI France appellent aussi à se coordonner contre les licenciements.
Mais toutes les initiatives que nous pouvons prendre, aussi correctes et combatives soient-elles, ne doivent pas nous faire oublier que c’est encore les directions des principaux syndicats du pays qui ont dans leurs mains le levier le plus puissant pour unifier les salariés dans la grève générale. Sans se bercer d’illusions envers des bureaucrates, qui ne construiront jamais de gaieté de cœur un plan de bataille conséquent, nous devons les interpeller, démasquer leurs responsabilités aux yeux des collègues et de nos camarades syndicalistes (débat que nous avions déjà eu chez les cheminots l’an dernier).
Car la passivité n’est pas éternelle, et peut être brisée à partir du moment où les travailleurs croient en leurs propres forces, en la possibilité de faire plier l’adversaire. L’ambiance dans le pays à la veille du mouvement des Gilets jaunes avait quelque chose de ça. Une telle radicalité, qui aurait à s’exprimer pas seulement dans des manifestations mais par la grève sur les lieux de travail, poserait de toutes autres perspectives de lutte.
Comme l’écrit Trotsky dans le texte que nous avons mentionné , dans un chapitre intitulé « Pourquoi les masses ne font-elles pas écho aux appels du Parti Communiste ? » :
« Et pourtant, la lutte pour les revendications immédiates a pour tâche d’améliorer la situation des ouvriers. En mettant cette lutte au premier plan, en renonçant pour elle aux mots d’ordre révolutionnaires, les staliniens considèrent sans doute que c’est précisément la lutte économique partielle qui est le plus capable de soulever de larges masses. Il s’avère précisément le contraire : les masses ne font presque aucun écho aux appels à des grèves économiques. Comment est-il donc possible en politique de ne pas tenir compte des faits ? Les masses comprennent ou sentent que, dans les conditions de la crise et du chômage, des conflits économiques partiels exigent des sacrifices inouïs que ne justifieront en aucun cas les résultats obtenus. Les masses attendent et réclament d’autres méthodes, plus efficaces. Messieurs les stratèges, mettez-vous à l’école des masses : elles sont guidées par un sûr instinct révolutionnaire. »
En résumé, en tant que révolutionnaires, nous ne rejetons pas la responsabilité des défaites ou de la passivité sur les masses ouvrières. Notre bataille en ce sens dans les syndicats, que nous menons dans une perspective anti-bureaucratique, de lutte de classe et pour l’auto-organisation, ne se fera pas chacun de notre côté. Elle doit s’incarner, comme l’écrivait Lénine alors que le phénomène de bureaucratisation des syndicats était à ses débuts, dans des « fractions révolutionnaires dans les syndicats » qui soient capables de rendre majoritaire cette ligne combative. Construire cela, pour récupérer les syndicats et en faire de vrais outils au service de la lutte de classes, c’est l’objectif d’un parti révolutionnaire, d’un grand parti révolutionnaire qu’il nous reste à construire en France, si l’on veut en finir une fois pour toute avec le système capitaliste et son lot d’exploitation et d’oppressions. C’est une partie de la bataille que nous menons en ce moment, au sein du NPA en vue du Congrès à venir, contre son explosion et pour la construction d’un Parti de combat, qui tire les leçons des luttes récentes et rassemble le meilleur des militants de ces luttes autour d’une stratégie clairement révolutionnaire.