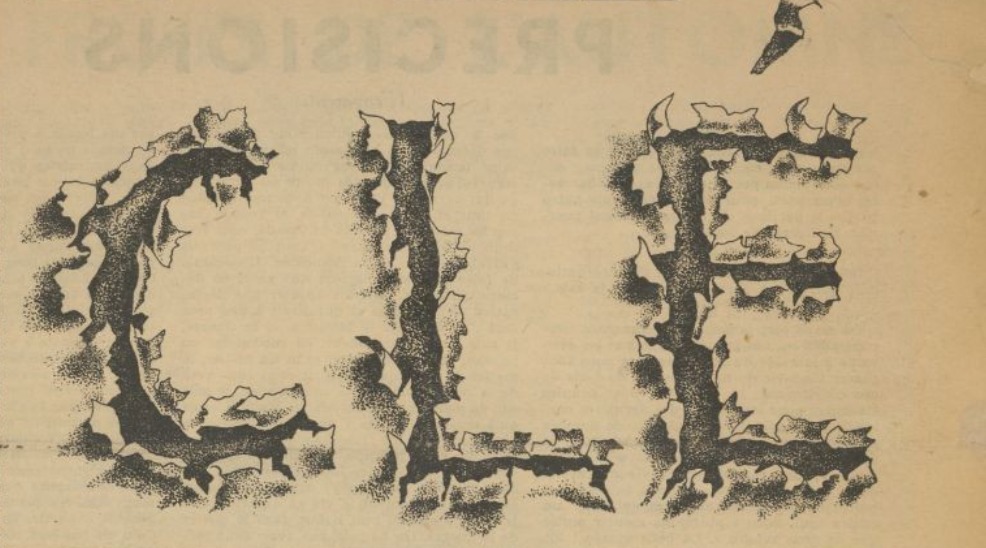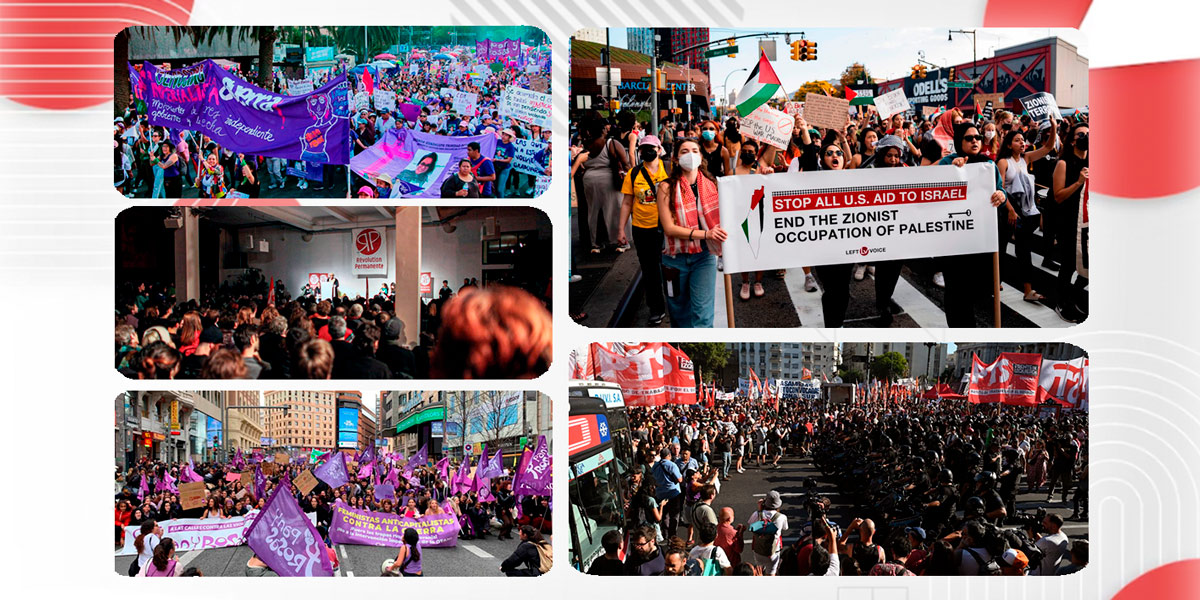La volonté d’instaurer, avec la loi ORE et le dispositif Parcoursup, une sélection drastique à l’entrée de l’université, ne fait certes que prolonger l’une des avancées les plus profondes du néolibéralisme à l’université depuis 15 ans : l’ingérence multiforme du capital dans son financement et son façonnement idéologique. Elle en constitue cependant un tournant important, et la crise qui vient de s’ouvrir ouvertement révèle un malaise à la hauteur de cette attaque au long cours. La réponse actuelle de la jeunesse étudiante, même si le mouvement actuel n’a pas encore atteint une échelle de masse, montre qu’elle est loin de l’atonie qu’on lui veut lui prêter en général afin de conjurer le spectre de sa révolte.
La diversité des dimensions du problème et sa complexité exigent une enquête très large [1]. Sans revenir, en particulier, sur l’engagement d’une fraction, réelle mais minoritaire, des personnels enseignants et administratifs à ses côtés, nous abordons ici quelques contradictions ou contrastes particulièrement saillants affectant le mouvement étudiant actuel.
Une situation transitoire : ou, quand l’ancien se meurt et que le nouveau peine à naître…
« A partir du moment où le but est de satisfaire les besoins en cadres de l’industrie privée, il y a forcément une sélection, parce qu’il est faux, contrairement à ce qu’on croit souvent, qu’il y ait une harmonie entre le développement d’une société capitaliste avancée et l’augmentation de la demande de spécialistes qui en résulte. Il y a au contraire une dysharmonie complète. L’augmentation du nombre des étudiants est - heureusement - beaucoup plus rapide que celle du nombre de cadres réclamés par l’industrie. C’est ce qui conduit à dire qu’il y a "trop" d’étudiants. Trop par rapport à quoi ? Par rapport aux besoins de l’industrie, sûrement ! Tous vont se présenter alors qu’elle n’en réclame que quelques-uns : l’Université, conçue pour la servir, éliminera les autres en cours de route. La seule réforme valable - qui serait une révolution - consisterait à inventer une université dont le but ne serait plus de sélectionner une élite mais d’apporter la culture à tous, même à ceux qui ne seront pas des "cadres".
[Mais] La sélection commence évidemment bien avant l’Université. C’est dès l’école primaire que s’opère le premier clivage entre les élus et les parias. »
Jean-Paul Sartre, « La jeunesse piégée », Propos recueillis par Serge Lafaurie, Le Nouvel Observateur, 17 mars 1969, in Situations VIII, « Autour de 68 », Paris, Gallimard, 1972 (p. 253-254).
Le mouvement étudiant contre la loi ORE et Parcoursup est traversé par une série de contradictions exprimant le caractère transitoire dans lequel il se trouve. La période antérieure de structuration forte par les organisations traditionnelles (UNEF, Solidaires EtudiantEs, organisations de l’extrême-gauche) est en bonne part révolue aujourd’hui. Mais le mouvement étudiant est bien loin de s’être forgée une nouvelle identité. Il se situe donc dans une phase de recomposition active, dont on peut dater le début, nationalement, au mouvement de 2016 contre la Loi Travail, où une nouvelle forme d’existence et de structuration a commencé à tenter de se forger, à tâtons, péniblement. Ce qui induit, comme dans toute situation transitoire par définition hybride, des contradictions, des contrastes, en résumé ce qu’on pourrait appeler (par analogie avec l’usage que fait Trotsky de ce concept pour décrire l’état de certaines sociétés marquées par des combinaisons d’éléments très avancés et d’autres très retardataires), un « développement inégal et combiné » du mouvement étudiant, autant sur le plan de ses formes de conscience que de ses logiques de structuration, d’organisation et d’autoreprésentation. Même si le mouvement est encore in progress et donc susceptible de se transformer, cinq contradictions ou types de contradictions nous semblent prédominer. Nous tentons ici de les aborder en partant des plus immédiatement visibles, quitte à procéder de façon un peu schématique pour insister sur les questions qui travaillent en sous-main.
1ère contradiction : des assemblées générales massives sans mouvement de rue
La première contradiction est la plus évidente, c’est celle qui donne du grain à moudre au discours du gouvernement et de Macron selon lequel ce mouvement serait le fait d’une « minorité » de « professionnels du désordre » ou « d’agitateurs professionnels » : autant il y a des AG massives dans un certain nombre d’universités, et des occupations avec une certaine pérennité, autant le mouvement étudiant est invisible ou presque dans la rue à l’échelle nationale - élément renforcé par l’absence, en l’état actuel et mis à part localement à l’image de Tours, du mouvement lycéen.
A l’inverse de la mobilisation du printemps 2016 contre la loi Travail, où les AG étaient réduites alors qu’une avant-garde large de la jeunesse défilait dans les rues, le mouvement actuel à ceci de comparable à celui de 2007 contre la LRU qu’il ne s’exprime quasiment pas vers l’extérieur en tant que mouvement étudiant [2]. Par souvenir ou sentiment ancré (par exemple au regard des millions de personnes qui ont manifesté en 2010 contre la réforme des retraites de Sarkozy, sans que cela n’aboutisse à la moindre victoire) de l’inutilité politique de ces démonstrations de masse ? Par dispersion dans de multiples actions locales ? Par peur, compréhensible, de la répression (ce qui la rend d’autant plus facile aujourd’hui, même au-delà du nécessaire) ? Sous la pression énorme des examens de fin d’année, matraquée autant localement qu’au niveau gouvernemental, suffisamment puissante pour démobiliser un certain nombre d’indécis au-delà de la participation aux assemblées générales ? Sous celle du financement des études qui impose à une proportion très importante des étudiants de devoir travailler en dehors de l’université, ce qui rend logiquement moins disponible, en termes de temps et d’énergie, pour manifester ou participer à des actions régulières ?
Autant de facteurs, non exclusifs, qui jouent nécessairement dans la situation, et dont la proportion serait à analyser plus finement. Mais ces facteurs sont indissociables de contradictions plus spécifiques animant le mouvement tel qu’il s’organise au sein même des universités.
2ème contradiction : blocages et occupations : tactiques ou « formes de vie » ?
« Mai 68 : la France vaque à ses occupations » (Graffiti, Hall Science-Po, 1968) [3]
La seconde contradiction, emblématique et sûrement l’élément le plus saillant de l’intérieur, concerne en effet la dynamique des blocages et des occupations. Cette dynamique s’est mise véritablement en marche suite au tournant représenté par l’agression des étudiants mobilisés de Montpellier III par une milice armée. Elle a clairement poussé, dans toute une série d’universités, une avant-garde étudiante parfois très large à s’organiser sur des bases radicalisées, et élevé le niveau de confrontation avec l’institution, mais portant ce risque inhérent d’une coupure avec la masse silencieuse des étudiants. Deux visions « idéal-typiques » des blocages et occupations sont à distinguer face à cette difficulté.
La première conception les considère de longue date comme un moyen d’action pour construire un rapport de forces. Comme toute grève véritable, ce qu’ils bloquent, c’est la normalité, c’est-à-dire le remplissement par l’université de deux fonctions-clés : qualifier une main d’œuvre employable sur le marché en se pliant à ses injonctions, c’est-à-dire sa fonction de machine à produire des diplômés ; s’assurer de l’intériorisation par la masse étudiante des coordonnées ou de la grille idéologiques de l’ordre existant (en matière de soumission à la gouvernance, au marché et à la sélection concurrentielle). Les opérations de blocage suspendent cette double fonction : d’où le chantage aux examens exercé par le gouvernement et ses relais sur le premier volet [4] . Sur le second, pour peu qu’ils donnent réellement lieu à un débat politique et pas seulement à des cours « alternatifs » plus ou moins juxtaposés, ils ouvrent un espace de subversion profond où, justement, le sens, le contenu et les objectifs des études par exemple peuvent être questionnés. Où émergent d’autres façons de réfléchir aux rapports des savoirs et des besoins sociaux. Où, par-delà les revendications sur les moyens et le combat de ces contre-réformes iniques, ressurgit parfois cette idée pas si absurde que produire, apprendre et décider collectivement, en surmontant les hiérarchies de statuts et l’atomisation du quotidien, rend tout le monde plus intelligent [5] .
Mais surtout, ils ouvrent un temps et un espace destinés à favoriser l’émergence d’une politique alternative, et de la politique pour le mouvement lui-même et ses revendications. Ce en quoi leur fonction reste avant tout, dans le cadre d’une lutte sur des revendications spécifiques, celle de moyen tactique (même s’il est éventuellement reconduit durablement). Cela s’oppose à la logique consistant à en faire prématurément ou de façon sous-politique une fin en soi. Entre ces deux conceptions la différence est fondamentale.
La seconde vision en effet concentre une logique in fine de repli sur soi, alimentée par un ensemble de facteurs comprenant ceux abordés ci-dessus, et d’autres sur lesquels on revient plus bas, faisant l’objet d’une défense voire d’une théorisation spécifiques. Effet à retardement des logiques type « Occupy », du mouvement des « indignations », mais surtout du modèle particulièrement parlant en France, du fait de l’histoire et du sort actuel de Notre-Dame-Des-Landes, de la « ZAD », la logique des occupations est fortement marquée, tout particulièrement sous l’influence des courants autonomes (aussi divers soient-ils), par la « logique du squat » et de la « forme de vie alternative ». Cette logique vise à coaguler les colères, en faire le combustible d’une alternative communautaire, rompant avec l’atomisation quotidienne comme la soumission aux formes de la propriété privée, et de la gestion disciplinaire de l’espace et du temps, au final, au profit d’une logique de type « communisme ici et maintenant ». De là, occupations et blocages tendent à devenir leur propre fin, une fin en soi, sur le modèle de l’enclave alternative, éthico-affinitaire, du micro-monde en rupture avec une société devenue insupportable sur tous les plans. Subjectivement compréhensible, cette logique, face à la difficulté à mobiliser à une échelle plus de masse, contribue cependant in fine à cette dernière tout en s’appuyant dessus pour se justifier, ce qui en fait une logique objective de l’impuissance.
Ces deux conceptions s’entrecroisent ou s’entrechoquent à des degrés divers [6] , avec tous les dégradés intermédiaires imaginables, chaque situation locale en exprimant, selon sa trajectoire propre et l’état des forces politiques organisées en présence, une combinaison hybride et mouvante. Dans leurs formes les plus politiques, elles visent également à la construction d’un rapport de force contre le pouvoir, le gouvernement, et ses appareils idéologiques (médias) comme répressifs. Mais leurs options stratégiques restent profondément divergentes.
3ème contradiction : enjeu de la démocratie et défis de l’auto-organisation
« Laissons la peur du rouge aux bêtes à cornes » (Graffiti, 1968, Beaux-Arts) [7]
Cette divergence s’exprime en particulier, reflet d’un déficit d’expérience et de tradition, sur le terrain de l’auto-organisation démocratique, en termes de vie et de construction du mouvement. Le degré de conflictualité entre ces deux logiques ne peut qu’avoir une incidence sur le fonctionnement plus global du mouvement, sa construction, la physionomie des assemblées générales, et leur capacité à être le lieu par excellence de l’élaboration démocratique de la politique de la lutte.
Ce principe fondateur du mouvement révolutionnaire selon lequel « l’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes », dès qu’on le décline comme méthode propre de construction des luttes, suppose ici que le centre de gravité politique du mouvement étudiant soit les assemblées générales, comme lieu où se discute et se décide, en totalité, à la fois l’organisation du mouvement, sa structuration, et l’ensemble des revendications dont il doit se doter. La volonté explicite de certaines franges du mouvement autonome de contourner sinon de casser les cadres d’auto-organisation de ces AG, au nom du noyautage bureaucratique (réel ou prétendu) de ces derniers par les organisations (syndicales et politiques) traditionnelles, est en réalité aussi une forme de bureaucratisation et de captation anti-démocratique du mouvement. Il contribue à accroître la déconnexion entre occupations, actions et AG, mais de ce fait aussi à sous-politiser ou dépolitiser les assemblées générales elles-mêmes, les réduisant à l’arène d’un débat réduit par exemple à la question du blocage ou des examens. Naturellement cela conduit à ce que la politique se pense et se fasse dans leur ombre ou à leurs marges.
Si des AG intersectorielles de secteurs en lutte, par exemple interprofessionnelles, étaient véritablement possibles, elles fourniraient un complément central à la structuration de l’auto-organisation à l’échelle, par exemple, d’une ville. Mais quand des AG dites « de lutte » ouvertes à n’importe quels groupes ou individus, sont prônées en opposition aux AG spécifiquement étudiantes (comme si celles-ci n’étaient pas aussi des AG « de lutte »…), prétextant leur corporatisme, leur noyautage, ou encore derrière l’absolutisation sans contenu de la « convergence des luttes » (sur quoi nous revenons plus bas), c’est de ce fait l’existence et la nécessité d’un mouvement étudiant en propre qui se retrouvent niées.
Concrètement, si les AG étudiantes (ou communes personnels-étudiants) n’ont plus cette totale souveraineté politique au sein même du mouvement, chacun ou chaque courant au sein de ce dernier peut y aller de son lobbying plus ou moins affinitaire en faveur de ses propres priorités, des activités ou actions qu’il juge juste, hors de tout contrôle collectif… D’où un régime de dispersion « multitudinaire », dont les contrastes dans la représentation et l’usage des blocages et occupations comme l’existence de deux cadres de coordination au plan national sont les échos. Un tel régime de dispersion nuit autant à la construction d’une conscience politique propre du mouvement étudiant, qu’à la démocratie et à l’efficacité de ses mobilisations. En définitive, c’est encore ce qui fait de l’auto-organisation la plus large possible, comme condition du débat politique sur ses perspectives et son orientation propre, un principe capital pour et en vue de tout mouvement étudiant de masse puissant et coordonné avec l’ensemble des autres luttes de classes.
Cristallisation des contradictions : l’absence de direction et de coordination unifiée au plan national
Il existe actuellement deux « coordinations nationales » principales de la mobilisation étudiante . Une « des luttes » (CNL) essentiellement animée par la mouvance autonome, l’autre « des étudiant-es » (CNE), qui cherche à actualiser les cadres des CNE qui ont structuré les mouvements antérieurs [8]. Le type de structuration des CNE antérieures s’est considérablement transformé dans les dernières années. Du fait combiné, d’abord, d’un discrédit croissant des appareils traditionnels qui y prédominaient jusque-là (à l’image de l’UNEF et ses manœuvres bureaucratiques ou boutiquières), et de l’affaiblissement tout court de ces appareils, en particulier les anciens satellites directs ou indirects du PS (UNEF, MJS, JC, UEC), dans la foulée de l’effondrement de ce dernier. Cela en a produit un « affaiblissement » au sens où un certain nombre d’habitudes et de méthode d’organisation se sont perdues du même mouvement. Mais, à l’image de la crise des médiations et de l’encadrement réformistes caractéristique des périodes de « crise organique », cela ouvre à des possibilités d’auto-organisation renouvelées sur des fondements beaucoup plus démocratiques et des bases radicales, issues du cœur des mouvements locaux. Même si la FI, de son côté, s’efforce de capitaliser un maximum, dans le principe un peu plus à gauche, sur la crise de ces organisations plus traditionnelles, et d’augmenter sa pénétration dans la jeunesse, elle n’est malgré tout pas capable de faire la différence, et va parfois jusqu’à compenser en reconduisant à son tour ces pratiques anti-démocratiques injustifiables. C’est l’ensemble de ces organisations-là qui se trouvent dans une situation où elles n’arrivent pas à constituer une direction crédible du mouvement.
En résumé, cette faiblesse inédite de relais des organisations traditionnelles dans le mouvement desserre l’étau bureaucratique qui a pu sévir par le passé, limite les possibilités de contention et donne plus de possibilités objectives à l’auto-organisation. Mais simultanément, l’absence d’organisations suffisamment mûres capables à échelle nationale de proposer une véritable alternative, même si le NPA jeunes par exemple, certains collectifs ou syndicats locaux, travaillent en ce sens, finit également par constituer un autre type de frein au mouvement. D’où une perte d’hégémonie de ces cadres, et un terrain laissé relativement vacant sur lequel, de fait, les logiques et politiques autonomes trouvent à se développer. Une fois n’est pas coutume, ces dernières sont un symptôme parlant de la situation de transition actuelle : cette dualité des coordinations, même s’il existe des possibilités de les rapprocher auxquelles il faut travailler, cristallise en l’état l’absence de direction nationale unifiée du mouvement, est donc une plus grande preuve de son immaturité politique.
Il est frappant de voir que la condamnation des réformes et de la répression, la conscience de la nécessité de s’organiser localement comme nationalement, jusqu’à l’appel à la grève générale, sont communs à la CNL et la CNE, par exemple dans son dernier appel (Paris 8 Saint Denis, 21 et 22 avril). La persistance de cette dualité de coordinations ne peut signifier qu’une chose : par-delà des préoccupations générales communes et des homologies dans la lettre, des divergences sur l’auto-organisation, le rôle des assemblées générales démocratiques, la stratégie, et sur le sens et les conditions de construction de le « convergence des luttes » (comme on va y venir ci-après) à une échelle de masse, continuent de jouer à plein.
4ème contradiction : une « convergence des luttes » polysémique
Pour analyser cette polysémie, repartons d’abord de l’hypothèse selon laquelle le mouvement étudiant actuel n’est pas (pas encore) un mouvement de rue, notamment parce qu’il pâtit du manque de perspectives dans la situation d’ensemble (les cheminots ne sont pas en reconductible, il n’y a pas de perspective de grève générale etc.), comme on l’a évoqué plus haut, mais aussi parce qu’il manque de perspectives propres, c’est-à-dire concernant la lutte sur le plan de l’université même. « Manque de perspectives », c’est-à-dire d’abord opacité ou insuffisances sur le plan des objectifs et de fins qui lui soient propres, suffisamment conscientisées, résultats d’une confrontation d’idées suscitant un assentiment majoritaire, et suffisamment convaincantes sinon enthousiasmantes pour alimenter un engagement durable et large. Bref, une carence sur le « programme », c’est-à-dire sur ce pour quoi il faut lutter. Mais aussi et corrélativement carence sur comment lutter, qui alimente le doute sur les moyens, stratégiques et tactiques, susceptibles de gagner contre le gouvernement.
Face au rouleau-compresseur de la dernière décennie, et au sentiment social encore ancré selon lequel une victoire sera très difficile, on peut considérer que joue à plein la persistance pour des raisons combinées, un scepticisme encore tenace, lisible en filigrane, sur les possibilités du mouvement. Une tentative de réponse, croisant ce double manque de perspectives, s’exprime cependant par l’aspiration plus présente que jamais à la « convergence des luttes ». Mais le contenu et les formes de ce leitmotiv généralisé sont eux-mêmes extrêmement hétérogènes. La « convergence des luttes » a remplacé le « tous ensemble » (de 1995 par exemple). Mais alors que le « tous ensemble » est un slogan, un mot d’ordre aussi symbolique que politique, la « convergence des luttes » joue en apparence sur un terrain plus stratégique (appeler à la « convergence », c’est constater l’existence d’une multiplicité de luttes, et estimer nécessaire de les combiner pour faire poids contre l’ennemi commun et ses politiques). Mais en réalité elle joue le rôle d’une formule fourre-tout qui ne présume en rien de ses voies de sa concrétisation. On peut en distinguer schématiquement là encore, deux conceptions « idéal-typiques », la réalité se chargeant d’en présenter, de même que pour le rapport aux blocages et occupations, toutes sortes de combinaisons intermédiaires.
Le premier type de conception est celle de la convergence conçue comme coagulation de luttes diverses et variées, vues comme essentiellement indépendantes, chaque lutte en valant une autre, mais dont l’unification est cependant nécessaire en raison de l’existence d’un ennemi commun (le gouvernement et ses politiques antisociales, réactionnaires, répressives etc.). Ici c’est l’ennemi qui est le principe unificateur, qui est le principal sujet de l’affrontement. Cette conception est très enracinée dans la constellation post-marxiste, traverse autant les courants autonomes que le néoréformisme et le populisme de gauche de type Laclau-Mouffe, et donne évidemment lieu à des variantes importantes. Ces dernières (et le mélenchonisme en est le prolongement politique) pensent par exemple la convergence au nom et au service d’un « peuple » éminemment flou, contre les élites, conception qui dissout totalement les frontières de classe et opacifie, par exemple, la relation spécifique étudiants-travailleurs.
Face à cette conception verticaliste, l’option plus horizontaliste de type Toni Negri, celle des « multitudes » comme autant de sujets politiques indépendants, devant se rencontrer pour faire bloc, anime, consciemment ou non, les courants plus autonomes. Certains au sein de ces derniers, à l’image de ceux influencés par le Comité Invisible, radicalisent la question de l’ennemi, moyennant le prisme d’un Foucault par exemple, selon lequel cet ennemi commun n’est pas tant, en tous cas pas seulement, le gouvernement, mais le « pouvoir » se logeant partout et tout le temps, en tout un chacun. L’approche conduit alors démultiplier le flou sur les revendications et les priorités, sur la distinction entre tactique et stratégie, et conduit à saper à la base l’idée pourtant centrale de cette « convergence » : à savoir la nécessité de construire un front commun, opérationnel, contre un adversaire identifié comme principal au moins conjoncturellement [9]. Mais un élément commun à ces variantes parfois formellement très différentes, élément déterminant, est l’invisibilisation (ou en tout cas, très forte minoration) de la classe ouvrière comme centre de gravité de l’alternative à construire – élément qui constitue, dans un certain nombre de cas et même si ce n’est pas conscient, le fondement objectif de certaines alliances de fait entre la FI et les courants autonomes.
Face à cette conception de la convergence-juxtaposition soit sans principe structurant, soit avec un principe structurant mais éthéré, illusoire ou carrément mystificateur – le « peuple » de Mélenchon par exemple est bien un « signifiant » extrêmement « flottant », comme le revendiquait Laclau – une conception opposée de la convergence part de la centralité de la classe travailleuse, et se pense comme unité de résistance et d’offensive fondée sur un point de vue de classe, contre l’ennemi commun et ses politiques réactionnaires. Une telle unité doit pouvoir s’exprimer au travers d’un « programme commun » de revendications défensives comme offensives, c’est-à-dire exprimant l’existence d’intérêts communs, et capable de s’incarner en une force de frappe régulièrement unifiée dans l’action. Cette conception de la « convergence des luttes » est une conception de l’hégémonie politique fondée sur l’idée que le centre de gravité de la situation est la lutte de classes, que toute victoire réelle doit s’appuyer sur les intérêts communs de la majorité des exploités et opprimés ou cibles des attaques (et, lorsqu’il peut y avoir tensions ou mêmes divergences de classe, par une politique d’alliances bien ciblée). Ici le principe structurant ce n’est pas l’ennemi à lui seul : c’est aussi le sujet social, ouvrier et populaire, avec le mouvement étudiant comme une de ses fractions ou allié majeurs, tel qu’il à être consciemment reconstruit en vue d’une action de masse, aux antipodes de toute logique minoritaire ou substitutiste.
Entre ces deux conceptions, par-delà les similitudes formelles et indépendamment du fourmillement d’actions ponctuelles de convergence (manifestations, rassemblements, meetings blocages d’axes routiers, etc.) qui peuvent mobiliser tout le monde, le fossé reste potentiellement énorme et en permanence ouvert à dislocation.
5ème contradiction : entre tendances à la dissolution et réactions corporatistes
Dans le prolongement direct de cette dualité, l’immaturité du nouveau mouvement étudiant peut se mesurer à l’aune de deux écueils opposés, qui s’alimentent mutuellement, et qu’il faudrait simultanément dépasser. D’un côté, l’écueil corporatiste, selon lequel le mouvement étudiant devrait seulement s’occuper de ses revendications purement « sectorielles », ce qui évidemment s’oppose par principe à toute logique de convergence. Cet écueil est le moins visible actuellement, notamment parce que les organisations qui le portent traditionnellement sont en crise profonde ou qu’elles peuvent difficilement l’assumer dans le contexte actuel, et existe avant tout sous forme de réaction épidermique à l’écueil le plus évident qui est la tendance (fût-elle aussi contradictoire) à la dissolution, à se laisser happer par le premier type vision, erroné, de la convergence. Un symptôme, par-delà les revendications immédiates, est que les étudiants mobilisés se pensent encore très peu, parfois pas du tout, comme un sujet politique spécifique, ayant ou devant avoir un programme et une orientation propre.
Par-delà les revendications défensives contre ORE et Parcoursup ou la question des moyens matériels (plan de financement, de créations de postes, de locaux etc.) – types de revendications auxquelles se réduisent, quand elles existent, les conceptions et réactions corporatistes –, on peut constater, à une échelle large, une grande faiblesse sinon une absence de réflexion profonde et en propre, pleinement politique et idéologique sur l’université telle qu’elle est et telle qu’elle devrait être, réflexion sur la base de laquelle le mouvement étudiant pourrait reconstruire son identité et sa force propre, et sur cette base, aux antipodes du corporatisme, redevenir un fer de lance de l’alliance stratégique ouvrière-étudiante, au sens de la seconde conception résumée plus haut de la « convergence des luttes ».
Trois dimensions d’une identité historique à reconstruire
Le mouvement étudiant actuel est, comme traditionnellement par le passé, animé par une volonté et un affect de solidarité profond avec l’ensemble des luttes existantes (travailleurs, cheminots, Notre-Dame-Des-Landes, migrants…). Mais ni volonté ni affects ne suffisent pour construire une stratégie, et le flou régnant autour de la « convergence » est le reflet de cette faiblesse d’élaboration. Au titre du débat qu’ouvre la situation transitoire actuelle, des éléments de caractérisation matériels, objectifs (sociologiques, économiques, historiques) comme subjectifs (du point de vue du rôle politique), sont essentiels : nous en évoquerons trois.
(i) Bien qu’elle soit structurellement polyclassiste, une fraction importante de la jeunesse étudiante, par-delà ses origines sociologiques, constitue dorénavant elle-même une frange du monde du travail contemporain (contrairement aux années 68, où justement l’Université était réservée à une fraction d’élite, aux enfants des classes supérieures). Quasiment la moitié des 2 millions et quelques d’étudiants en France doivent travailler, c’est-à-dire se faire exploiter au travers de multitudes d’emplois et contrats ultra-majoritairement partiels et précaires, pour payer leurs études. Le milieu étudiant, suite aux réformes de l’après-68 qui ont « massifié-démocratisé » l’université, est traversé de contradictions objectives pour cette raison : il a énormément grossi, s’est complexifié, et s’il est traditionnellement une caisse de résonance des malaises de la société toute entière, il l’est aussi pour les contradictions de classes qui la caractérisent. Des intérêts contradictoires affectent donc la « jeunesse étudiante », raison pour laquelle elle est aussi le théâtre d’affrontements de classe. Mais, simultanément, et bien que sociologiquement la proportion d’étudiants issus des milieux les plus ouvriers et populaires y reste minoritaire, la réalité de sa condition sociale et économique le rapproche tendanciellement à une large échelle de la condition ouvrière d’aujourd’hui, avec des degrés de prolétarisation parfois scandaleusement avancés.
(ii) Cela renforce la possibilité de renouer avec son rôle historique sur le plan politique, qui est double. D’abord, celui d’une « avant-garde tactique », c’est-à-dire d’un détonateur explosif au regard du mouvement ouvrier (en particulier lorsqu’il investit très visiblement la rue, et face à la répression). Ce rôle est favorisé par le fait que le mouvement étudiant n’a malgré tout jamais été encadré par des organisations aussi fortes que celles du mouvement ouvrier (aussi en crise les grandes organisations syndicales soient-elles actuellement). Mais cela se prolonge au niveau de son rôle d’allié stratégique du mouvement ouvrier contre le pouvoir du capital. Seuls, les étudiants ne peuvent pas faire reculer le gouvernement, en particulier parce qu’ils ne peuvent bloquer le noyau dur de l’économie. En revanche, ce qui fait peur à tous les gouvernements, c’est lorsqu’ils se lient avec les travailleurs et utilisent leur inventivité et leur capacité d’entraînement en ce sens (comme en 1968, 1986, 1995, 2006…).
(iii) Le mouvement étudiant sera d’autant plus fort qu’il redeviendra subjectivement capable, en repolitisant pleinement ces possibilités et ces spécificités objectives, de remettre en chantier le sens et les missions de l’université (au-delà des débats ou cours « alternatifs » pouvant se tenir ici ou là en marge des assemblées générales) et de se re-massifier à échelle suffisante au sein même de l’université, en se donnant comme but de réinvestir l’espace public en son nom propre, en partant des spécificités de son milieu, de ses conditions d’étude et de travail, des besoins sociaux spécifiquement attachés, etc. Mais cela n’a rien à voir a priori avec le moindre corporatisme dès lors qu’on a en tête que ceci constitue un premier niveau, et non le tout, de la perspective. En effet, plus il sera puissant et conscient sur ses bases propres, plus il aura de facilité à massifier ses combats en s’en pensant comme sujet spécifique. Et plus il sera capable, in fine, prolongeant ses propres revendications, qui ne peuvent qu’aboutir, dans une société de classes, à rejoindre celles des autres luttes, de jouer son rôle d’allié stratégique puissant de l’ensemble des travailleurs et des combats contre l’oppression. Par exemple la construction collective de meetings de convergence importants, avec les cheminots en particulier, comme celui de Toulouse le 10 avril 2018, co-organisé par les étudiants et personnels grévistes (mais aussi, par-delà les différences de contexte et de résultats, à Tolbiac, à Montpellier), démontre le fait que sur la base de ses propres forces et de ses propres préoccupations, la possibilité d’une convergence réelle se trouve justement renforcée.
« J’emmerde la Société, mais elle me le rend bien » [10]
Mais pour aller au-delà de réussites ponctuelles et construire les choses dans la durée, le renforcement qualitatif à la fois de son « programme » (c’est-à-dire d’un ensemble d‘objectifs et de revendications propres) et de sa « méthode » (la plus démocratique et ouverte possible), est incontournable, et constitue un quatrième volet majeur du débat. Les étudiants (de même que les personnels des universités, enseignants, administratifs, techniques, etc.,) ont raison de se révolter. Cette révolte est actuellement marquée par une rupture de continuité importante, en matière de traditions et de réflexes. Ce n’est pas étonnant, à l’échelle nationale, le dernier véritable mouvement de masse victorieux des étudiants remonte au CPE en 2006. Ce sont deux à trois générations d’étudiants qui, de fait, ne sont pas passées par une telle expérience cruciale. Mais nous sommes aux débuts d’un renouveau.
Dans l’immédiat de la conjoncture, l’instabilité de la situation interdit d’en écrire prématurément la suite. L’entrée des lycéens dans la danse (au sortir des premiers résultats des vœux sur Parcoursup, par exemple), pourrait faire flamber à une toute nouvelle échelle le mouvement tel qu’il existe présentement. De même qu’une radicalisation de la grève des cheminots pourrait l’attiser. Mais une chose est certaine : la tâche d’explication au service de la massification, pour reprendre la rue avec une force nouvelle, un effort redoublé sur le terrain de la bataille d’opinion pour convaincre largement, atteignent une situation d’urgence critique au vu de la pression croissante aux examens et la très proche fin des cours. L’avant-garde mobilisée, aussi hétérogène soit-elle, est donc face à une tâche difficile : il faut se donner le maximum de moyens pour convaincre les plus grandes franges possibles de la « masse silencieuse » que leur avenir comme celui de l’université vaut bien, au moins temporairement, la grand-messe des examens.
A l’échelle plus structurelle et historique, en revanche, la révolte seule ne suffira pas. En vérité l’université doit être véritablement révolutionnée – perspective d’une vaste « réforme intellectuelle et morale » reposant sur un programme de transformation sociale et économique profonde, aurait dit Gramsci. Outre les revendications défensives et matérielles, un tel programme devrait poser à nouveau, sous tous les angles, la question de la démocratie à l’université, de son régime de pouvoir, de ses hiérarchies institutionnelles, symboliques, pédagogiques et mettre en avant l’abime qui sépare l’université d’aujourd’hui, de celle que nous sommes légitimés à souhaiter. Nous devrons donc discuter des fins, autant que des moyens requis pour les atteindre. Et comme la physionomie, les contradictions et la crise actuelle de l’université sont forgées par la société de classes dans laquelle nous vivons, par voie de conséquence, cela nous imposera de réfléchir à quelle société nous voulons mettre à la place, et comment la conquérir.
NOTES
[1] Beaucoup de choses ont été récemment publiées. Cf. par exemple ledossier publié dans Contretemps « Dossier : l’Université saisie par le néolibéralisme, entre marchandisation et résistances » ; sur Parcoursup voir par exemple, Philippe Blanchet, « Idéologique, injuste, infaisable… », 7 avril 2018 ; sur « la destruction de l’université française », cf. l’entretien avec Christophe Granger au sujet de son livre de 2015 qui porte ce titre.
[2] Cf. par exemple Hugo Melchior, « Où va le mouvement étudiant ? », 24 avril 2018, sur cette contradiction : « Pourtant, un paradoxe saute aux yeux quand on s’emploie à analyser de façon concrète l’état du mouvement actuel : la multitude d’AG, les « grèves actives » ne se sont pas traduites jusqu’à présent par un mouvement de masse dans l’espace public. Cette situation problématique pour les opposants à cette réforme n’est pas inédite. Elle peut rappeler, même si les contextes sont différents, la mobilisation de l’automne 2007 lorsque des étudiants, des lycéens et des enseignants-chercheurs décidèrent d’agir ensemble contre la loi cadre LRU. Celle-ci était une promesse du candidat Nicolas Sarkozy et visait à imposer un nouveau paradigme à l’Université française, celui de l’autonomie. […] Ces grèves, remettant en cause le cours normal de la vie universitaire, sont soutenues pratiquement et publiquement par de nombreux enseignants, mais aussi par des membres du personnel administratif, refusant de consentir à une réforme appréhendée comme une nouvelle étape dans le processus de « destruction de l’Université française ». Le recours à la force publique contre les foyers de contestation fait, quand à lui, l’objet de multiples condamnations. » Mais pourtant, « Depuis le début de la mobilisation… les rues des villes universitaires sont demeurées, sinon désertes, en tout cas vierges de toutes manifestations de masse comparables à celles survenues lors des mouvements étudiants victorieux que ce soit en 1986 (Devaquet), 1994 (CIP) ou 2006 (CPE). » Et l’auteur conclut : « Il faudra en passer par des manifestations massives de rue, car elles demeurent la condition nécessaire, sinon suffisante, pour espérer à un moment donné entraver les desseins d’un gouvernement déterminé. Aucun mouvement des jeunesses scolarisées n’a jamais réussi à triompher d’un pouvoir d’Etat sans être parvenu à faire descendre dans la sphère partagée des centaines de milliers de jeunes gens. » « Dans ces conditions, le mois de mai sera décisif… » résume-t-il.
[3] In Mai 68. Les murs ont la parole, Paris, Seuil, 2007.
[4] Examens, dont Sartre disait (« La jeunesse piégée », op. cit., p. 255), que le « vrai sens » est de « masquer la carence de l’enseignement et à décourager ceux dont on ne veut pas s’occuper […] décourager tous les étudiants dont notre société industrielle n’a pas besoin, c’est-à-dire dont la culture ne serait pas économiquement "rentable". » Examens qui, en ce sens, sont eux-mêmes l’instrument de sanctification de la fonction objective de sélection que doit assurer par nature, dans la société capitaliste, l’université. Cette réalité n’empêche évidemment pas la légitimité et la justesse d’un combat acharné pour une université gratuite et ouvertes à toutes et tous et d’un combat contre les dispositifs de sélection socialo-méritocratiques comme ceux de la loi ORE et Parcoursup. Il nous appartient d’étudier cette contradiction structurelle de toute université en régime capitaliste, ce sur quoi nous développerons quelques attendus dans la partie II de cet article.
[5] Où ressurgit donc, même, crime suprême, l’idée que les formes établies de l’ordre et de la « démocratie » officielle ne sont pas des lois de la nature… Idée qui devrait pourtant être le B-A BA de l’enseignement universitaire, et qui remonte aux grecs anciens.
[6] Cela peut passer par des clivages et des tensions très avancées, comme cela avait le cas au Mirail à Toulouse fin 2014, lors du mouvement étudiant local contre les violences policières suite à l’assassinat de Rémi Fraisse à Sivens,ou à plusieurs reprises à Tolbiac dans la séquence qui a précédé son évacuation brutale par la police ce printemps. Ou au contraire par des formes de coexistence et de bataille commune plus pacifiée, faisant par exemple que les AG communes se tiennent bien en commun, permettant de ce fait l’expression des désaccords, etc., comme au Mirail – fruit dans l’évidence d’une maturation et d’une décantation sur plusieurs années, depuis 2014. Mirail où le blocage, cependant, se traduit par deux occupations dans deux bâtiments distincts, illustrant en partie les différences de logique déjà évoquées. Plus largement les différences peuvent être très importantes d’une université à l’autre , contribuent au caractère disparate du mouvement étudiant actuel, qui se situe de fait à mi-chemin entre un mouvement national, et une somme de mouvements locaux. Preuve s’il en est de son état de « développement inégal et combiné ». Une analyse comparative et une cartographie précises seraient des plus utiles.
[7] Mai 68. Les murs ont la parole, op. cit.
[8] Une troisième, la CNX, a tenté d’émerger contre les deux autres. A quoi il faut ajouter la CN lycéenne, et celle, qui va se réunir pour la première fois les 5-6 mai, en même temps que la CNE, des personnels en grève de l’université (CNU). Que ces deux dernières se rencontrent au plus vite sera essentiel.
[9] Pour approfondir sur le volet autonomes cf. E. Barot & J. Chingo, « Enjeux conceptuels et débats stratégiques sur la révolution à venir. Au sujet du dernier essai du Comité invisible "A nos amis" » ; « L’antipolitique autonome et ses illusions » ; Camille Münzer, « Sur "Maintenant" le dernier ouvrage du Comité invisible », R. Nitchivo « En finir avec le cortège de tête ? ». Sur néoréformisme et populisme de gauche, voir par exemple : C. Cinatti, « Laclau, Mouffe, Badiou : quelques réflexions sur les élections, le populisme et la révolution », E. Barot, « De Laclau à Iglésias : théorie et pratique du (néo)populisme » et le débat« Podemos, France Insoumise, Populismes de gauche, et nouveaux réformismes ».
[10] Graffiti, 1968, lycée Condorcet, in Mai 68. Les murs ont la parole, op. cit.
[1] Cf. le dossier publié dans Contretemps « Dossier : l’Université saisie par le néolibéralisme, entre marchandisation et résistances » ; sur Parcoursup voir par exemple, Philippe Blanchet, « Idéologique, injuste, infaisable… », 7 avril 2018 ; sur « la destruction de l’université française », cf. entretien avec Christophe Granger au sujet de son livre de 2015 qui porte ce titre.
[2] Cf. par exemple Hugo Melchior, « Où va le mouvement étudiant ? », 24 avril 2018 Ces grèves, remettant en cause le cours normal de la vie universitaire, sont soutenues pratiquement et publiquement par de nombreux enseignants, mais aussi par des membres du personnel administratif, refusant de consentir à une réforme appréhendée comme une nouvelle étape dans le processus de « destruction de l’Université française ». Le recours à la force publique contre les foyers de contestation fait, quant à lui, l’objet de multiples condamnations. » Mais pourtant, « Depuis le début de la mobilisation… les rues des villes universitaires sont demeurées, sinon désertes, en tout cas vierges de toutes manifestations de masse comparables à celles survenues lors des mouvements étudiants victorieux que ce soit en 1986 (Devaquet), 1994 (CIP) ou 2006 (CPE). » Et l’auteur conclut : « Il faudra en passer par des manifestations massives de rue, car elles demeurent la condition nécessaire, sinon suffisante, pour espérer à un moment donné entraver les desseins d’un gouvernement déterminé. Aucun mouvement des jeunesses scolarisées n’a jamais réussi à triompher d’un pouvoir d’État sans être parvenu à faire descendre dans la sphère partagée des centaines de milliers de jeunes gens. » « Dans ces conditions, le mois de mai sera décisif… » résume-t-il.
[3] In Mai 68. Les murs ont la parole, Paris, Seuil, 2007.
[4] Examens, dont Sartre disait (« La jeunesse piégée », op. cit., p. 255), que le « vrai sens » est de « masquer la carence de l’enseignement et à décourager ceux dont on ne veut pas s’occuper […] décourager tous les étudiants dont notre société industrielle n’a pas besoin, c’est-à-dire dont la culture ne serait pas économiquement "rentable". » Examens qui, en ce sens, sont eux-mêmes l’instrument de sanctification de la fonction objective de sélection que doit assurer par nature, dans la société capitaliste, l’université. Cette réalité n’empêche évidemment pas la légitimité et la justesse d’un combat acharné pour une université gratuite et ouvertes à toutes et tous et d’un combat contre les dispositifs de sélection socialo-méritocratiques comme ceux de la loi ORE et Parcoursup. Il nous appartient d’étudier cette contradiction structurelle de toute université en régime capitaliste, ce sur quoi nous développerons quelques attendus dans la partie II de cet article.
[5] Où ressurgit donc, même, crime suprême, l’idée que les formes établies de l’ordre et de la « démocratie » officielle ne sont pas des lois de la nature… Idée qui devrait pourtant être le B-A BA de l’enseignement universitaire, et qui remonte aux Grecs anciens.
[6] Cela peut passer par des clivages et des tensions très avancées, comme cela avait le cas au Mirail à Toulouse fin 2014, lors du mouvement étudiant local contre les violences policières suite à l’assassinat de Rémi Fraisse à Sivens, ou à plusieurs reprises à Tolbiac dans la séquence qui a précédé son évacuation brutale par la police ce printemps. Ou au contraire par des formes de coexistence plus pacifique, faisant par exemple que les AG communes se tiennent en commun et correctement, comme au Mirail – fruit dans l’évidence d’une maturation et d’une décantation depuis 2014 – , mais où le blocage se traduit cependant par deux occupations dans deux bâtiments distincts, illustrant clairement les différences de logique. Plus largement les différences peuvent être très importantes d’une université à l’autre, ce qui contribue au caractère disparate du mouvement étudiant actuel, qui se situe de fait à mi-chemin entre un mouvement national, et une somme de mouvements locaux. Preuve s’il en est de son état de « développement inégal et combiné ». Une analyse comparative et une cartographie précises seraient des plus utiles.
[7] in Mai 68. Les murs ont la parole, op. cit.
[8] Une troisième, la CNX, a tenté d’émerger contre les deux autres. A quoi il faut ajouter la CN lycéenne, et celle, qui va se réunir pour la première fois les 5-6 mai, en même temps que la CNE, des personnels en grève de l’université (CNU). Que ces deux dernières se rencontrent au vite sera essentiel.
[9] Pour approfondir sur le volet autonomes cf. E. Barot & J. Chingo, « Enjeux conceptuels et débats stratégiques sur la révolution à venir. Au sujet du dernier essai du Comité invisible "A nos amis" », ainsi que « L’antipolitique autonome et ses illusions » ; Camille Münzer, « Sur "Maintenant" le dernier ouvrage du Comité invisible », R. Nitchivo « En finir avec le cortège de tête ? ». Sur néoréformisme et populisme de gauche, voir par exemple : C. Cinatti, « Laclau, Mouffe, Badiou : quelques réflexions sur les élections, le populisme et la révolution », E. Barot, « De Laclau à Iglésias : théorie et pratique du (néo)populisme » et le débat « Podemos, France Insoumise, Populismes de gauche, et nouveaux réformismes ».
[10] Graffiti, 1968, lycée Condorcet, in Mai 68. Les murs ont la parole, op. cit